ANDRÉ MARTINET
FONDATEUR
DE LA SILF
ET DE LA REVUE
LA LINGUISTIQUE


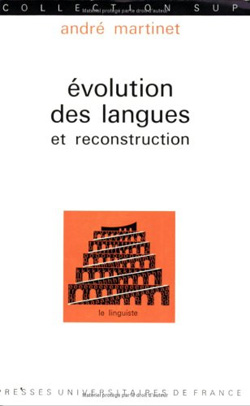

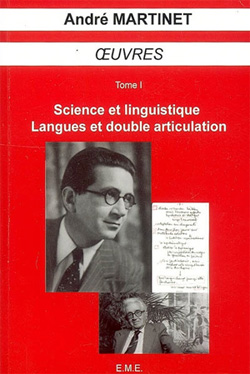
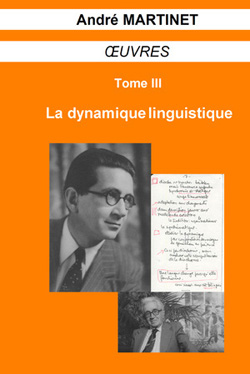
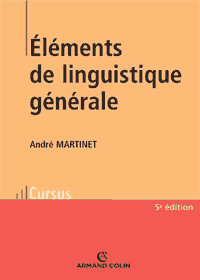

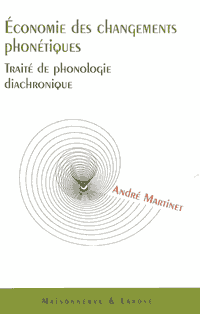
|

ANDRÉ MARTINET EN QUELQUES DATES
1908 : Naissance en Savoie
1930 : Agrégation d’anglais
1932 : Premiers contacts avec N. S. Troubetskoy et l’École de Prague
1936 : Publication de l’article «Neutralisation et archiphonème»
1937 : Doctorat d’Etat ès-lettres
1937 : Titulaire de la Direction d’études de phonologie à l’EPHE
1945 : Publication de La prononciation du français contemporain
1946 : Départ pour les USA
1947 : Directeur de la revue Word Chef du Département de Linguistique à Columbia University
1955 : Retour en France, titulaire de la chaire de linguistique générale à la Sorbonne Publication d’Economie des changements phonétiques
1956 : Publication de La description phonologique
1957 : Titulaire de la Direction d'études de linguistique structurale à l’EPHE
1960 : Publication des Eléments de linguistique générale
1964 : Quitte la direction de la revue Word
1965 : Crée la revue La Linguistique, aux Presses Universitaires de France
1974 : Premier Colloque international de linguistique fonctionnelle à Groningue
1976 : Création de la SILF
1979 : Publication de la Grammaire fonctionnelle du français
1985 : Publication de Syntaxe générale
1987 : Publication du livre Des steppes aux océans
1995 : Arrêt de l’enseignement à l’EPHE
1999 : Décès à Châtenay-Malabry
BIOGRAPHIE D'ANDRÉ MARTINET
12 avril 1908 - 16 juillet 1999
Par Jeanne Martinet
André MARTINET est né le 12 avril 1908 à St.-Albans-des-Villards, en Savoie.
Sa petite enfance se passe dans les villages où ses parents sont instituteurs et où, de ce fait, il vit avec sa sœur dans des conditions linguistiques dont il a dégagé ultérieurement le caractère bilingue et qui suscitent chez lui un intérêt précoce pour les problèmes de langue. À onze ans, il vient à Paris avec sa famille.
Agrégé d'anglais en 1930, à vingt-deux ans, il élargit tout de suite son horizon aux langues germaniques d'abord, puis à la linguistique générale.
Dès 1932, constatant le parallélisme de ses conceptions avec celles de l'École de Prague, dont le Manifeste de Phonologie a été présenté au Congrès de La Haye, en 1928, par Troubetzkoy, Jakobson et Karcevsky, il établit des contacts épistolaires avec Troubetzkoy et publie en 1936 «Neutralisation et archiphonème» dans le volume 6 des Travaux du Cercle linguistique de Prague.
Dans le même temps, du fait de fréquents séjours au Danemark, il noue d'amicales relations avec les Danois Louis Hjelmslev et Hans Uldall et participe, dans une certaine mesure, à l'élaboration de la glossématique qui voit le jour en 1943 avec le livre Omkring sprogtheoriens grundlaeggelse et sera révélée, hors du Danemark, par le copieux compte rendu qu'André Martinet en donne dans le Bulletin de la Société de linguistique de Paris en 1946.
Docteur ès-lettres avec une thèse principale sur La gémination expressive en germanique et une thèse complémentaire consacrée à La phonologie du mot en danois, André Martinet est nommé à l'automne 1937, titulaire de la Direction d'études de phonologie qui vient d'être créée à l'École pratique des Hautes Études, à la Sorbonne.
La seconde Guerre mondiale a pour effet d'interrompre tous contacts entre les linguistes de nationalités différentes. Prisonnier de guerre, André Martinet met à profit sa captivité pour réaliser l'enquête d'où sortira plus tard La prononciation du français contemporain.
L'armistice trouve l'École de Prague démantelée: Troubetzkoy est mort en 1938, Jakobson est à New York et il est difficile d'établir des relations avec ceux qui sont restés en Tchécoslovaquie.
En 1946, André Martinet accepte l'invitation qui lui est faite de diriger les recherches de l'International Auxiliary Language Association à New York, où il va s'établir. Il y retrouve Jakobson et tous deux luttent contre l'isolationnisme des linguistes américains pour faire connaître la linguistique européenne
.
Les contacts s'établiront assez facilement avec les disciples de Sapir : Morris Swadesh, Harry Hoijer, Mary Haas, ultérieurement avec Kenneth Pike, et plus difficilement avec Bloomfield.
En collaboration avec Swadesh, puis avec Joseph Greenberg, Uriel Weinreich et enfin Louis Heller, il assure de 1947 à 1964-65 la direction de la revue Word. Fait sans précédent sur la scène américaine, il maintient, non sans difficulté, la règle que Word publie des articles en français aussi bien qu'en anglais.
Nommé en 1947 chef du Département de Linguistique à Columbia University, André Martinet assure l'enseignement non seulement de la linguistique synchronique, mais aussi de la linguistique comparée des langues indo-européennes et de la linguistique diachronique, ce qui lui donne l'occasion d'élaborer et de développer la théorie relative à l’économie et à la dynamique linguistiques qu'il présentera dans Économie des changements phonétiques, publié à Berne en 1955.
On notera que si André Martinet défend la nécessité de maintenir bien distincts les points de vue synchronique et diachronique, il ne retient pas l'identification de ces termes avec statique et dynamique, Pour sa part, il n'a jamais envisagé les faits linguistiques autrement que dans leur dynamisme.
La présentation qu'il fait de Saussure dans ses séminaires incite Wade Baskin à traduire le Cours.
André Martinet l'encourage et établit avec Genève les contacts qui permettront de mener à bien l'entreprise. Francis Whitfield qui, pour mieux pénétrer la pensée glossématique, s'était attaqué à la traduction du texte danois, le consulte à plusieurs reprises au cours de l'année 1951-1952.
André Martinet l'incite à prendre contact avec Hjelmslev et convainc ce dernier, au cours de son passage à New York au printemps 1952, de l'intérêt de cette traduction, qui paraîtra sous le titre: Prolegomena to a Theory of Language. En même temps, à la demande de Hjelmslev, André Martinet soumet à une critique décisive une traduction française qui sera à la base de la première édition des Prolégomènes.
En revanche, les recherches touchant aux universaux du langage qui commencent à voir le jour à cette époque lui inspirent des réserves, qui se confirment lorsque ceux-ci deviendront une mode. Il ne retient pour sa part, comme universaux, que ceux qu'il intègre dans sa définition d’une langue.
Une fois précisé ce qu'est une langue, la linguistique visera très exactement à rechercher ce qui, dans une langue donnée, la caractérise et la différencie des autres langues.
Alors s'accusent les divergences de vues avec Jakobson : aux apriorismes de celui-ci s'oppose le réalisme d'André Martinet, qui ne pourra pas se montrer indéfiniment solidaire en public des points de vue qu'il combat en privé dans leurs rencontres et leurs longues conversations téléphoniques.
La conciliation apparaîtra comme impossible sur le binarisme.
Lorsqu'André Martinet rentre en France, en 1955, il obtient à la Sorbonne la chaire de linguistique générale.
Il n'y a plus de chaire de phonologie à l'École pratique des Hautes Études mais on y crée pour lui, en 1957, une Direction d'études de linguistique structurale.
Dès lors, outre l'enseignement élémentaire qu'il assure à la Sorbonne et qui aboutit à la publication en 1960 des Éléments de linguistique générale, traduit aujourd'hui dans près de vingt langues, André Martinet forme de nombreux chercheurs dans ses séminaires à l'École pratique des Hautes Études et dirige des thèses de doctorat portant sur les langues les plus variées. La multiplication de ses tâches administratives ne ralentit guère sa production scientifique.
En 1965, il fonde la revue La Linguistique conçue essentiellement comme tribune du fonctionnalisme linguistique. L'activité scientifique d'André Martinet apparaît comme étroitement liée au développement de la linguistique contemporaine.
Sa vision linguistique, ramassée dans la définition qu'il a donné d'une langue, correspond à une élaboration positive qui s'est faite constamment en contact avec la pensée d'autrui, mais rarement sous sa pression directe. «En méditant philosophiquement sur chaque notion», écrit Bachelard, «on verrait aussi plus clairement le caractère polémique de la définition retenue, tout ce que cette définition distingue, retranche, refuse».
Un examen attentif de la définition proposée par André Martinet révèle que, malgré son caractère positif, non polémique, cette définition est en fait oppositive et marque à chaque point sa différence à l'égard de telle ou telle théorie. «Une langue», écrit-il, «est un instrument de communication selon lequel l'expérience humaine s'analyse, différemment dans chaque communauté, en unités douées d'un contenu sémantique et d'une expression vocale, les monèmes ; cette expression vocale s'articule à son tour en unités distinctives et successives, les phonèmes, en nombre déterminé dans chaque langue, dont la nature et les rapports mutuels diffèrent eux aussi d'une langue à une autre».
Les éléments de cette définition restent incontestablement dans la ligne saussurienne et il n'a pas échappé à Tullio de Mauro qu'André Martinet est, en fait, le plus saussurien des linguistes de sa génération.
On relèvera toutefois que l'objet de la définition est une langue et non la langue, ce qui rappelle qu'André Martinet écarte finalement la dichotomie langue-parole et qu'il oppose, en fait, le monde des signes saussuriens, quelles que soient leurs dimensions : monème, syntagme, phrase... à l'unité distinctive de base, le phonème.
Au distributionnalisme de Bloomfield et de ses disciples qui, en rejetant catégoriquement le sens, ignore la distinction signifiant-signifié et réduit finalement l'analyse linguistique à une segmentation en «constituants» qui se hiérarchisent de façon linéaire, des traits distinctifs à la phrase, en passant par le morphème, chaque constituant de rang supérieur étant fait d'un certain nombre de constituants du rang immédiatement inférieur, s'oppose la double articulation en monèmes à deux faces et phonèmes à face unique.
La hiérarchisation qu'implique la double articulation s'oppose aussi au parallélisme des deux plans hjelmsléviens, comme l'insistance sur l'expression phonique oppose la formulation d'André Martinet à la conception strictement relationnelle et non substantielle qui a caractérisé les premiers temps de la glossématique.
Enfin, l'insistance sur les différences entre les communautés de locuteurs et sur les différences entre les langues, manifeste le refus d'opérer avec des universaux ou des modèles a priori en opposition aux vues globalistes de Jakobson.
L'apparition sur la scène des grammaires transformationnelles et génératives n'a rien apporté qui puisse modifier les positions d'André Martinet.
Les critiques de Chomsky et de ses épigones s'adressaient à un bloomfieldianisme étriqué, dénoncé par André Martinet dès les années 40, et la plupart des contributions d'inspiration chomskyenne se situent, en fait, dans des cadres logiques, sémantiques ou psychologiques, étrangers à une linguistique qui s'attache avant tout à l'étude des langues dites «naturelles».
Pour un fonctionnaliste, il n'y a rien à glaner dans cette énorme production qui se fonde sur des présupposés totalement différents des siens.
André Martinet n'a jamais cédé à la pression formalisante qui aboutit à mettre dans le coma la langue à l'étude. À chaque temps de la recherche fonctionnaliste, un nouvel angle de vision est choisi qui permet d'intégrer à la linguistique proprement dite tout ce que d'autres voudraient en distinguer sous les termes de sociolinguistique, de pragmatique ou d'énonciation.
Si André Martinet s'est d'abord fait connaître par sa contribution à la phonologie, condensée et illustrée dans son ouvrage La description phonologique paru en 1956, sa direction, au cours des années 50 et 60 d'un nombre considérable de thèses sur les langues les plus variées, surtout africaines, lui permet d'élaborer une théorie syntaxique qui trouvera son application dans sa Grammaire fonctionnelle du français, publiée en 1979, et son expression au plan théorique, six ans plus tard, dans sa Syntaxe générale.
La pratique de la recherche en synchronie débouche sur une conception dynamique de celle-ci. II ne s'agit plus de figer à tout jamais la réalité langagière dans un instantané, mais bien d'observer le film d'un développement en perpétuel devenir, celui de l'évolution de toute langue dans son fonctionnement. Une synchronie fonctionnelle est donc nécessairement une synchronie dynamique, ce que résume la formule: «Une langue change parce qu'elle fonctionne».
Sous la pression de ses auditoires parisiens, André Martinet se replonge dans les études comparatistes qui l'ont toujours passionné et qui ont représenté une part importante de ses activités new-yorkaises. Il y consacre deux enseignements annuels à l'École pratique des Haute Études.
Ils aboutissent à un panorama de l'expansion, à travers le temps et l'espace, des peuples de langue indo-européenne, et à une esquisse dynamique de la structure des formes linguistiques, depuis ce que nous pouvons atteindre par la reconstruction interne jusqu'aux différentes formes qu'a prise la langue après la dissolution d'une unité primitive C'est ce qui apparaît clairement dans son ouvrage intitulé Des steppes aux océans. L’indo-européen et les « Indo-Européens ».
Sur un plan plus général, les théories fonctionnalistes inspirent la création d'une sémiologie fonctionnelle dont les principaux représentants sont Luis Prieto, Georges Mounin et la rédactrice de ces lignes. Dans le même temps se constitue, autour d'André Martinet, une véritable école fonctionnaliste.
À l'initiative de certains de ses étudiants et disciples de New York et de Paris, est organisé, à Groningue, en 1974, un premier Colloque international de linguistique fonctionnelle, où se rencontrent pour la première fois des chercheurs qui partagent les mêmes vues et souhaitent échapper pour un temps à l'agressivité d'un chomskysme alors triomphant. À cette première rencontre succèdent des colloque annuels qui se tiennent, chaque fois dans un nouveau pays.
Bien qu'à la retraite depuis 1977, André Martinet, professeur émérite de l'Université René Descartes, n'interrompt pas ses activités d'enseignement, de recherche et de publication. Il donnera jusqu’en 1995 sa conférence hebdomadaire à l'École pratique des Hautes Études.
Pendant des années il continuera à assurer de nombreux enseignements à travers le monde en tournées de conférences ou en séminaires, du Mexique au Japon, de l'Université la plus méridionale, Valdivia au Chili,
à la plus septentrionale, Oulu en Finlande.
En dépit d'accidents de santé qui ne lui permettent plus guère de se déplacer à partir de 1996, il garde ses fonctions éditoriales à La Linguistique, tient des réunions chez lui et publie encore quelques articles.
Deux sujets le passionnent : les origines et l'histoire de l'alphabet et des écritures en général, l'apparition du langage chez l'enfant. Sur le premier, il laisse quelques pages d'un manuscrit inachevé, ébauche d'un travail dont il mesure l'ampleur et qu'il n'envisage pas de pouvoir mener à bien.
Le second nous vaut «L'écholalie», publié dans La Linguistique en 1998, un point de départ de ce qu'il aurait souhaité faire.
PRINCIPAUX OUVRAGES D’ANDRE MARTINET
On ne donne ici que la liste des livres rédigés ou dirigés par André Martinet.
Pour une bibliographie complète, incluant les articles de l’auteur et un recensement des compte rendus
et traductions de ses œuvres, voir :
Henriette et Gérard WALTER, 1988, Bibliographie d’André Martinet, Louvain - Paris, Peeters,
SELAF N° 279, 114 p..
Un complément à cette bibliographie a été publié en 1998 par H. et G. Walter
Pour le commander, contacter la SILF : SILF@silf-la-linguistique.org
1937 La gémination consonantique d’origine expressive dans les langues germaniques, thèse principale de Doctorat d’Etat, Copenhague, Munksgard, 224 p.
1937 La phonologie du mot en danois, thèse complémentaire de Doctorat d’Etat, Paris, Klincksieck, 100 p.
1945 La prononciation du français contemporain, Paris, Droz, 249 p.
1945 Questionnaire of the International Auxiliary Language Association, New York, International Auxiliary Language Association, 98 p.
1947 Initiation pratique à l’anglais, Lyon, IAC, 311 p.
1949 Phonology as Functional Phonetics, Londres, University of Oxford Press, 40 p.
1954 Linguistics today, (dir. AM et Uriel Weinreich), New York, Linguistics Circle of New York, 280 p.
1955 Economie des changements phonétiques : Traité de phonologie diachronique, Berne,
Francke Verlag, 396 p.
1956 La description phonologique, avec application au parler franco-provençal d’Hauteville (Savoie), Genève, Droz et Paris, Minard, 108 p.
1960 Eléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin, 224 p.
1962 A Functional View of Language, Oxford, Clarendon, VIII + 166 p.
1965 La linguistique synchronique, Paris, PUF, « Le linguiste », VIII + 246 p.
1965 Manuel pratique d’allemand, Paris, Picard, 176 p.
1968 Le langage (dir. AM), Encyclopédie de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1541 p.
1969 Le français sans fard, Paris, PUF, « SUP, Le linguiste », 221 p.
1969 La linguistique, Guide alphabétique (dir. AM), Paris, Denoël, 490 p.
1973 Dictionnaire de la prononciation française sans son usage réel (en collaboration avec Henriette Walter), Paris, France-Expansion, 932 p.
1975 Evolution des langues et reconstruction, Paris, PUF, « SUP, Le linguiste », 264 p.
1975 Studies in Functional Syntax – Etudes de syntaxe fonctionnelle, Munich, W. Flinck, 275 p.
1979 Grammaire fonctionnelle du français, Paris, Didier et Saint-Cloud, CREDIF, XII + 276 p.
1980 Dictionnaire de l’orthographe : alfonic, (en collaboration avec Jeanne Martinet), Paris, SELAF,
16 + 201 p.
1981 Linguistique et sémiologie fonctionnelle, (en collaboration avec Jeanne Martinet), Istanbul,
Université d’Istanbul, 80 p.
1983 Vers l’écrit avec alfonic (dir. AM), Paris, Hachette, 174 p.
1983 L’indo-européen, Paris, Université René Descartes, UER de linguistique générale, 75 p.
1985 Syntaxe générale, Paris, Armand Colin « Coll. U », 266 p.
1985 Thémata leitourgikés súntaxis, Athènes, Nephele, 344 p.
1986 Des steppes aux océans. L’indo-européen et les « Indo-Européens », Paris, Payot, 274 p.
2004 Economie des changements phonétiques. Traité de phonologie diachronique, (nouvelle édition remaniée par l’auteur en 1980 et préparée par Jeanne Martinet), Paris, Maisonneuve et Larose, 290 p.
  
|